122è Salon d’Automne : La révolution des avant-gardes au cœur de Paris
- Le Salon s’est tenu du 29 octobre au 02 novembre 2025, place de la Concorde 75008 Paris
Chaque année, Paris accueille un événement qui, depuis plus d’un siècle, sert de baromètre à la création artistique : le Salon d’Automne. Loin d’être une simple exposition, ce salon est une institution née d’une volonté de rupture et devenue le théâtre de certaines des plus grandes révolutions esthétiques du XXe siècle. Pour comprendre son importance, il faut plonger dans sa genèse, mesurer son impact sur les artistes et analyser sa capacité unique à réunir un public toujours curieux.
TOUT SAVOIR SUR CE SALON D’AUTOMNE
Une des plus belles expositions de Paris, cette année Place de la Concorde.
Il faut préciser que toutes les œuvres présentées sont sélectionnées par un Jury exigent .
Nombreux étaient les visiteurs.
Un rendez-vous à ne pas manquer .
Artistes, Peintres, Sculptrices, Sculpteurs
STEFAN BEIU
Peintre et Président de la SECTION HERITAGE et INNOVATION Du SALON D’AUTOMNE
Toile – Le Baiser Dans La Grange et toile – La Vierge Au Rocher
Mes rencontres avec :
LAIMA GODA – Versailles, spring
HORÉA – Lumière
LUDMILA TERNANO DOLGOVA – Le Sommelier
CHAMBON GILLES – Le Coeur Des Muses
KONOKO- La Mer Au Début de Crépuscule
JURGEN MARKE – Four Brothers
DIDIER THIRION – Étale De Basse Mer
PASCALE CARRIER – Émergence
L’ŒUF OU LA TOILE – Ambivalence
AUDIGANE MCA – Entre Terre et Spiritualité
DENYS EUSTACE – sans titre
DEDE – The White Screanning Silence
AMANDA RACKOWE – The Fool On The Hill
H.HAERING – Résilience n1 Enfance
JEAN-YVES LEGRAFIC – Pétales
CHRISTOPHE BADANI – Black Trombone
ADÉLAÏDE LACHAUX – Promesse DE Nectar
SERGE KREWISS – La Leçon D’Anatomie du Docteur Tulp
THIERRY KOLD – Quarta
CHRISTINE MAILLARD – Mitsuko avec un T
MARCEL BADA – Lolita
SOPHIE PIROT – Anne De Kiev
ANNE-SOPHIE GUICHENEY – Séduction
MALO A. – Mélopée
ROUHBAKHSH NEGIN – sans titre
MYRIAM BONIAS – Owens Le Guépard
ANNE YARDIN – Mister NO
GREGORY DUPONT – Eurythmie
La genèse d’une rébellion artistique : Rompre avec l’académisme
Au début du XXe siècle, la scène artistique parisienne est encore dominée par le Salon officiel, une institution prestigieuse mais sclérosée, dont le jury conservateur privilégie un art académique, lisse et convenu. Les jeunes artistes, porteurs de nouvelles visions, peinent à y trouver leur place. En réaction, d’autres salons émergent, comme le Salon des Indépendants, mais son principe « ni jury, ni récompense » conduit à des accrochages parfois peu lisibles et de qualité inégale.
C’est dans ce contexte qu’en 1903, un groupe d’artistes, d’architectes et de critiques se rassemble autour de l’architecte Frantz Jourdain (Guimard, Carrière, Desvallières, Bonnard, Rouault, Vallotton, Vuillard, Matisse, et tant d’autres…). Leur ambition est de créer un salon différent, un espace qui serait à la fois progressiste et sélectif. Le Salon d’Automne est né, avec plusieurs principes fondateurs :
- L’Ouverture à la nouveauté : Offrir une vitrine aux jeunes talents et aux courants émergents refusés ailleurs.
- La Pluridisciplinarité : Casser la hiérarchie entre les arts. La peinture et la sculpture y côtoient les arts décoratifs, la gravure, l’architecture et même la musique. C’est une vision totale de l’art.
- Un Jury d’artistes : Le jury est composé des artistes exposants eux-mêmes, garantissant une sélection par des pairs, plus à même de comprendre les nouvelles audaces.
- La Saisonnalité : Le choix de l’automne n’est pas anodin. Il permet aux artistes de présenter les œuvres réalisées durant l’été et se positionne intelligemment en décalage avec les autres grands salons qui ont lieu au printemps.
Dès sa première édition au Petit Palais, le succès est au rendez-vous, posant les bases d’une longue et riche histoire.
Un tremplin pour les maîtres de la modernité : Du scandale à la consécration
Plus qu’une simple alternative, le Salon d’Automne est rapidement devenu l’épicentre des avant-gardes. Son histoire est jalonnée de « scandales » qui sont en réalité les actes de naissance de mouvements artistiques majeurs.
- 1905 : La « Cage aux Fauves » et la naissance du Fauvisme C’est l’événement le plus célèbre associé au Salon. Dans la salle VII, les œuvres d’Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck et Albert Marquet explosent de couleurs pures, violentes, subjectives et non-imitatives. Au milieu de ces toiles aux tons stridents, une sculpture d’inspiration Renaissance semble perdue. Le critique d’art Louis Vauxcelles s’exclame alors : « Donatello au milieu des fauves !« . Le mot est lâché, le Fauvisme est né. Le scandale est immense, mais il propulse ces artistes sur le devant de la scène. La Femme au chapeau de Matisse, achetée par Gertrude Stein lors de ce salon, devient une icône de cette révolution.
- 1911 : L’affirmation du Cubisme Après ses premiers pas au Salon des Indépendants, le Cubisme s’expose avec force au Salon d’Automne. La salle XI de l’édition 1911, surnommée par dérision la « salle des cubistes », réunit des œuvres de Jean Metzinger, Albert Gleizes, Fernand Léger et Henri Le Fauconnier. Le public et une partie de la critique crient à l’imposture face à ces formes géométrisées et ces perspectives multiples. Pourtant, cet accrochage marque une étape décisive dans la reconnaissance et la diffusion du mouvement.
Au-delà de ces deux moments phares, le Salon d’Automne a servi de tremplin à d’innombrables artistes qui ont marqué l’histoire de l’art. On peut citer Constantin Brancusi, Amedeo Modigliani, Robert Delaunay, ou encore les artistes de l’École de Paris. Pour un artiste, exposer au Salon d’Automne signifiait non seulement être vu, mais aussi participer activement au dialogue bouillonnant de la modernité.
Une capacité unique à réunir les visiteurs : Le public Face à l’Avant-Garde
La force du Salon d’Automne réside également dans sa relation passionnelle avec le public. Il n’a jamais été un cénacle réservé à une élite initiée, mais un grand rendez-vous populaire.
- Le Moteur du Débat Public : Les scandales, loin de nuire au Salon, ont attiré les foules. Le public parisien venait pour voir, comprendre, mais aussi pour être choqué et pour débattre. Les articles de presse passionnés, les critiques virulentes et les discussions animées dans les allées faisaient du Salon un événement culturel et social incontournable. Il a joué un rôle essentiel dans l’éducation du regard du public, l’habituant progressivement aux audaces de l’art moderne.
- Un Pont entre Créateurs et Amateurs d’Art : En présentant des milliers d’œuvres d’artistes variés, le Salon est un lieu de découverte accessible. Il permet aux collectionneurs de repérer de nouveaux talents et au grand public de prendre le pouls de la création contemporaine dans toute sa diversité. Sa nature pluridisciplinaire en fait une expérience culturelle complète et enrichissante.
- Une Institution Pérenne : Aujourd’hui encore, le Salon d’Automne perpétue sa mission. Installé généralement sur les Champs-Élysées, il continue de présenter des artistes du monde entier, fidèle à sa vocation d’ouverture et de découverte. S’il n’a plus l’odeur de soufre de ses débuts, il reste un témoignage vivant de cette tradition parisienne de grands salons d’art, un lieu où l’héritage des maîtres du passé dialogue avec les promesses des créateurs de demain.
En conclusion, le Salon d’Automne est bien plus qu’une exposition. Il est le fruit d’une révolte nécessaire contre l’académisme, une scène qui a vu naître les mouvements fondateurs de l’art moderne, et un espace de rencontre démocratique entre les artistes et la société. Son histoire est celle de l’audace, de la controverse et, finalement, de la reconnaissance, prouvant que c’est souvent en bousculant les certitudes que l’art se réinvente et avance.

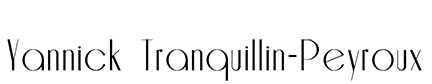







Comments are closed